À propos des vins de France
Aucun autre pays au monde ne produit un vin aussi excellent. Le vin est tellement ancré dans la culture nationale et les traditions locales qu'on pourrait presque parler d'une relation spirituelle. Même si la consommation de vin par habitant a diminué de moitié au cours des 50 dernières années et que la superficie viticole nationale a également considérablement diminué, la France joue un rôle unique dans le monde du vin. Bordeaux, la Bourgogne et, bien sûr, la Champagne sont mondialement connus, et pourtant le pays compte non pas trois, mais 300 régions viticoles.
Terroir - un concept controversé
La France est également le berceau du terme « terroir », dont la traduction exacte n'existe nulle part ailleurs. Ce terme définit le vin comme l'expression du sol, du climat et de la culture humaine. Ce concept est perçu avec une grande ambivalence dans le monde du vin. Les pays producteurs de vin non européens, en particulier, y voient davantage un stratagème marketing visant à consolider le statut du « Vieux Continent » et de la France comme premier producteur mondial de vin. Une perspective plausible, certes, mais pas suffisante pour disqualifier le concept. Que serait le Pinot Noir sans la Bourgogne et ses moines cisterciens ? Que serait le Cabernet Sauvignon sans les graves perméables du Bordelais ? Que serait la Champagne sans ses sols crayeux et les expérimentations médiévales de Dom Pérignon ? De notre point de vue, le terroir décrit les conditions particulières de la vinification, ses origines et son histoire, qui sont responsables des caractéristiques propres au verre, non seulement en France, mais partout où le vin est produit.
Une histoire mouvementée
Le vin français trouve probablement son origine dans les premières plantations de vignes par les Grecs vers 600 av. J.-C. Les Romains furent finalement responsables de sa diffusion systématique en Gaule, d'abord dans la vallée du Rhône, puis à partir du IIe siècle en Bourgogne et à Bordeaux. L'expansion de la viticulture s'accompagna de l'œuvre missionnaire chrétienne : les Églises avaient besoin de vin de messe, et les moines considéraient comme un devoir pieux de le cultiver. Avec la Renaissance, il devint un moyen de distinction sociale parmi la noblesse et la bourgeoisie aisée, et la demande en Europe augmenta considérablement. Au XVIIe siècle, la France comptait trois fois plus de vignobles qu'aujourd'hui.
En 1855, la Chambre de commerce de Bordeaux établit un classement des nombreux châteaux bordelais, toujours valable aujourd'hui. À la même époque, une maladie fongique aux conséquences dévastatrices apparaît pour la première fois dans les vignobles français : l'oïdium (mildiou) cause des dégâts considérables, entraînant presque l'échec total des vendanges de 1854. Le seul traitement efficace – le soufre, encore utilisé aujourd'hui – ne permet d'écarter le danger que pour un temps, car une autre menace pour la viticulture française apparaît rapidement : le phylloxéra. Probablement introduit d'Amérique, ce vilain insecte attaque les racines des vignes, provoquant leur mort et la mort de la plante entière. À partir de 1863, il se propage dans toute la France et détruit presque entièrement le vignoble. Ce n'est qu'en 1910 qu'un remède est trouvé : le greffage sur des porte-greffes américains, mais plusieurs cépages avaient déjà été éradiqués.
Les nouvelles plantations qui suivirent marquèrent un nouveau départ, toujours révolutionnaire aujourd'hui. Dès 1936, une délimitation géographique précise des zones de culture fut établie et des règles de production strictes furent instaurées. Plus la superficie était étendue, plus la réglementation était généreuse. Plus l'appellation était petite, plus les règles concernant les cépages, le rendement et la qualité étaient strictes. Le système des AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) était né. Aujourd'hui, on compte environ 1 000 appellations de ce type ; les autres sont simplement désignées sous le nom de « Landwein » (vins de pays) ou d'IGP (Indication Géographique Protégée). En particulier, la limitation des quantités imposée par la nouvelle réglementation a favorisé la qualité plutôt que la quantité.
Le modèle mondial
Rares sont les vignerons d'aujourd'hui qui nieraient avoir été influencés par les grands vins de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne ou du Rhône. La France est le berceau de plusieurs styles de cépages spécifiques, reproduits dans le monde entier ou du moins utilisés comme source d'inspiration : les chardonnays ou pinot noir de Bourgogne ; les assemblages bordelais de cabernet sauvignon, cabernet franc et merlot ; le sauvignon blanc des bords de Loire ; et, bien sûr, le champagne, mondialement connu. L'élevage en fûts de chêne français, l'élevage sur lies fines, le bâtonnage et la fermentation malolactique sont des variantes de vinification fréquemment utilisées pour conférer aux vins un raffinement absolu. On y trouve également le riesling, le sylvaner et le gewürztraminer d'Alsace ; le beaujolais du sud de la Bourgogne, du Jura, du Sud-Ouest et de Provence : autant de noms qui symbolisent des styles uniques et des qualités exceptionnelles. Même le sud du pays, région importante quantitativement, avec le Languedoc et le Roussillon, a connu une amélioration qualitative spectaculaire ces dernières décennies. Ainsi, la France préserve et célèbre son patrimoine hautement respecté tout en se réinventant et en se développant dans la tension entre tradition et modernité.

 Loire
Loire 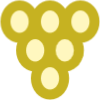 Cuvée, sec
Cuvée, sec frais et élégant
frais et élégant

 Languedoc
Languedoc 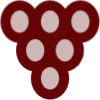 Cuvée, sec
Cuvée, sec sombre et herbacé
sombre et herbacé

 Champagne
Champagne 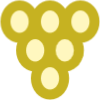 Cuvée, sec
Cuvée, sec élégant et structuré
élégant et structuré

 Champagne
Champagne 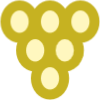 Cuvée, sec
Cuvée, sec épicé et puissant
épicé et puissant

 Loire
Loire 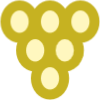 Sauvignon Blanc, sec
Sauvignon Blanc, sec intense et rocheux
intense et rocheux

 Rhône
Rhône 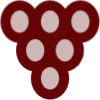 Cuvée, sec
Cuvée, sec fruité et épicé
fruité et épicé

 Languedoc
Languedoc 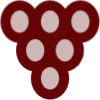 Cuvée, sec
Cuvée, sec élégant et éthéré
élégant et éthéré

 Loire
Loire 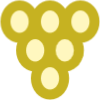 Sauvignon Blanc, sec
Sauvignon Blanc, sec concentré et minéral
concentré et minéral

 Rhône
Rhône 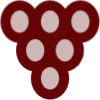 Cuvée, sec
Cuvée, sec juteux et minéral
juteux et minéral

 Rhône
Rhône 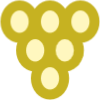 Cuvée, sec
Cuvée, sec corsé et élégant
corsé et élégant

 Bourgogne
Bourgogne 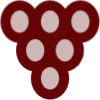 Pinot Noir, sec
Pinot Noir, sec épicé et élégant
épicé et élégant

 Rhône
Rhône 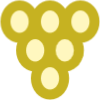 Cuvée, sec
Cuvée, sec corsé et élégant
corsé et élégant

 Bourgogne
Bourgogne 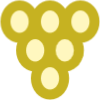 Chardonnay, sec
Chardonnay, sec élégant et profond
élégant et profond

 Loire
Loire 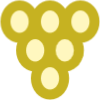 Sauvignon Blanc, sec
Sauvignon Blanc, sec concentré et rocheux
concentré et rocheux

 Loire
Loire 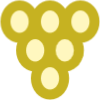 Sauvignon Blanc, sec
Sauvignon Blanc, sec végétal et soyeux
végétal et soyeux

 Bourgogne
Bourgogne 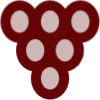 Pinot Noir, sec
Pinot Noir, sec fruité et juteux
fruité et juteux

 Bourgogne
Bourgogne 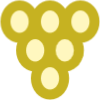 Chardonnay, sec
Chardonnay, sec minéral et complexe
minéral et complexe

 Loire
Loire 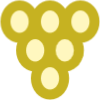 Sauvignon Blanc, sec
Sauvignon Blanc, sec intense et rocheux
intense et rocheux

 Bourgogne
Bourgogne 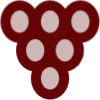 Pinot Noir, sec
Pinot Noir, sec minéral et complexe
minéral et complexe

 Bourgogne
Bourgogne 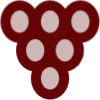 Pinot Noir, sec
Pinot Noir, sec élégant et structuré
élégant et structuré

 Bourgogne
Bourgogne 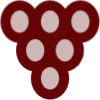 Pinot Noir, sec
Pinot Noir, sec structuré et épicé
structuré et épicé

 Loire
Loire 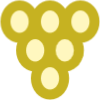 Sauvignon Blanc, sec
Sauvignon Blanc, sec concentré et minéral
concentré et minéral

 Rhône
Rhône 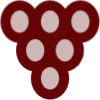 Cuvée, sec
Cuvée, sec intense et épicé
intense et épicé

 Bourgogne
Bourgogne 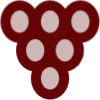 Pinot Noir, sec
Pinot Noir, sec délicat et complexe
délicat et complexe





















